Pour tromper l’ennui, Gatien compte les pièces de monnaie. Il aime savoir, au centime près, ce que contient sa caisse. À intervalles réguliers son regard effleure avec mépris l’énorme pieu de bois, grossièrement taillé en une forme vaguement animale, planté au beau milieu de la première salle d’exposition. Comment la conservatrice a-t-elle accepté, même temporairement, d’afficher ces soi-disant oeuvres ? Œuvres de malades mentaux, oui ! Gatien et ses collègues, habitués pourtant aux excentricités des artistes contemporains qui défilent au musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq, en sont restés tout pantois.
Trois jeunes déboulent soudain devant le comptoir. Cette expo attire vraiment de drôles d’oiseaux. Gatien referme discrètement sa caisse. Ces trois-là, avec leur crâne rasé, leur blouson de cuir clouté, leurs tatouages, lui plaisent encore moins que les collégiens goguenards ou les doux dingues qui envahissent les salles dès le matin. Le plus petit des trois s’assied d’un bond sur le comptoir sans tenir compte des « Je vous prie de descendre » de Gatien et commence par ergoter sur le prix des billets.
– Allez, tu nous la fais cette réduc, tu vois bien qu’on est étudiant ! Hein ? Quoi ? Une carte ? Articule, je t’entends pas. Ben, voilà, y’a qu’à demander gentiment.
Une carte plastifiée surgit entre son index et son majeur. Il en effleure le nez de Gatien qui recule brusquement la tête. Gatien a juste le temps d’y lire : Fabrice Mérieux, étudiant en droit.
– Eux, ce sont mes assistants. Ils n’ont pas besoin de carte. Tu ne vas pas nous emmerder avec ça.
L’étudiant mitraille alors Gatien de questions dont il fait lui-même les réponses : le genre des visiteurs, le choix des œuvres, les subventions, la couleur de la culotte de la conservatrice… Les deux autres s’exclaffent sans retenue aux plaisanteries douteuses de celui qui semble être leur chef. Tout cela met Gatien d’autant plus mal à l’aise qu’il partage une partie des assertions de ce trio peu recommandable. Il se débarrasse d’eux en leur délivrant trois billets étudiants. Définitivement Gatien déteste l’Art brut.
Il alerte aussitôt ses collègues par talkie walkie pour une surveillance étroite et il fait bien car en se penchant il s’aperçoit que les crânes rasés leur donnent du fil à retordre. Ils slaloment avec des rires gras entre les vitrines, franchissent les lignes blanches ou les cordons qui protégeent les oeuvres du public, changent les objets de place, bousculent les visiteurs, les prennent à témoin de leurs provocations.
Des jeunes filles, des mères de famille abandonnent bientôt leur visite non sans manifester leur indignation en passant devant Gatien.
D’abord les gardiens ont suivi les perturbateurs d’un pas tranquille, et de loin. Puis ils se regroupent frileusement et leurs conciliabules se font moins discrets : à quel moment intervenir ? Et de quelle façon ? Doit-on se faire casser la gueule par des gaillards qui pratiquent visiblement les arts martiaux pour défendre ces oeuvres mineures ? Ils envisagent même d’appeler la police si les choses devaient s’envenimer.
Subitement le trio échappe à leur surveillance. Les employés déroutés s’interrogent tout haut. On ne les entend plus, où sont-ils donc passés ? Ils les retrouvent dans la salle dite « militaire ». Là sont exposées les oeuvres les plus colorées : mitraillettes réalistes fabriquées à partir de déchets plastiques, maquettes d’avions rangées sagement par ordre de taille, poupées de bois aux uniformes chamarrés, faux insignes plus vrais que nature : le délire guerrier s’étale, rutilant, devant les trois jeunes, ébahis de la débauche de couleur. Impressionnés, ils ont fait un premier tour silencieux des vitrines, puis le fou rire les a gagnés quand ils se sont aperçus de la naïveté des réalisations.
– Eh, venez voir par ici, c’est la meilleure !
Stéphane attire ses comparses vers un tableau qui représente une file de soldats figés dans un uniforme vert brillant devant un chef obèse à cheval. À première vue le tableau n’a rien d’anormal, mais les garçons découvrent que les longues capotes militaires s’ouvrent discrètement sur des petits sexes rigides casqués de vert-de-gris.
Benoît reste bouche bée devant la charge caricaturale du tableau. Quant à Fabrice, qui se pique d’être un connaisseur en Arts, il explose :
– Les Nazis n’étaient pas aussi cons que nous. Ils n’avaient jamais permis que cette racaille expose dans leurs musées. Je te flanquerais tout ça dans un camp, moi !
Il expédie un crachat vers l’ignominie, mais la présence des employés qui l’épient de loin perturbe la trajectoire.
Il se penche alors sur une étiquette de carton collée au mur : « Josiane Westein, dite Josy, née en 1950, a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Ses grands-parents ont été déportés à Dachau. Fortement marqué par la violence militaire, elle réside néanmoins en face d’une caserne, d’où elle tire une certaine inspiration. Elle fréquente l’atelier thérapeutique du professeur Ben Amin, à l’hôpital Charcot de La Madeleine. »
– Westein… Elle est juive, cette salope. J’aurai dû m’en douter. Et le toubib, un bougnoule… La totale !
Fabrice examine avec attention la photo qui illustre une coupure de journal, épinglée au-dessous du carton. On y voit une silhouette féminine, de dos, échevelée, devant un gigantesque tableau, posé le long d’une baraque en bois, derrière laquelle on distingue la haute tige élancée d’une antenne de transmission.
– Ça, c’est une antenne militaire… Un bidonville, à côté d’une caserne… À tous les coups c’est à Lille. On devrait trouver facilement. On se casse !
Les deux autres lui emboîtent le pas sans discuter, au grand soulagement des gardiens. Dans l’allée qui les mène au parking, Fabrice explique son plan d’une voix froide et déterminée : il se sent investi d’une mission.
Ils se retrouvent quelques heures plus tard dans leur salle de sport habituelle : la mise en forme du corps est indispensable avant toute expédition. Le soir, chez Fabrice, ils se font amener des pizzas qu’ils arrosent de la rituelle bouteille de Bordeaux 1988, année des soixante ans de leur leader politique.
Les garçons attendent la nuit en écoutant en boucle le dernier tube techno. Fabrice étudie un plan de Lille, Benoît a apporté du crack. Ils n’auront sûrement pas besoin de matraques, la folle doit vivre seule. À minuit, ils roulent en direction de la porte de Gand.
Ils n’ont aucun mal à repérer le bidonville : quelques baraques sordides éparpillées sur un terrain vague, face à des bâtiments militaires. L’endroit est désert, à part le planton de service qui piétine son ennui à la grille de la caserne. Il tique en voyant jaillir d’une voiture trois silhouettes en treillis qui se fondent dans les buissons. Est-ce une manoeuvre pour tester sa vigilance ? Dans le doute, il se mobilise davantage sur sa faction.
Les trois complices se déplacent silencieusement de baraque en baraque : un coup d’œil rapide aux fenêtres et ils passent à la suivante. Tout au bout du terrain ils découvrent deux minuscules baraquements, comme des roulottes sans roues posées à même le sol. Par une vitre presque opaque de saleté, au milieu d’un capharnaüm d’objets insolites, ils devinent, aux lueurs tremblantes d’une dizaine de bougies, une silhouette féminine penchée sur une grande feuille blanche entourée de pinceaux.
Des aboiements rageurs venant d’un peu plus loin, probablement déclenchés par leur présence, les poussent alors à se réfugier dans la seconde bicoque. Ici encore une bougie, collée à même la table, leur révéle un fouillis crasseux d’objets hétéroclites, envahissant ce qu’ils identifient comme une cuisine et plus loin dans l’ombre, un coin repos.
– Qu’est-ce qu’on fait ? Chuchote Stéphane à l’adresse de son chef.
– On fouille, répond Fabrice. Y a peut-être de la thune. Avec les dingues, on ne sait jamais. Mais pas de bruit surtout. On s’occupera d’elle après.
En fait de thune, ils trouvent une caisse de bouteilles d’alcool dont certaines sont déjà entamées.
– Elle se mouche pas du pied, la salope… Du whisky, de la vodka. Y’a même du Sidi Brahim. Ça vient sûrement du toubib de l’hosto. Il doit la sauter, ce salopard.
– Tu rigoles, elle est à gerber. Même un crouille n’en voudrait pas. Où elle range son tire-bouchon, cette conne ?
En forçant un tiroir qui coince, Benoît le fait tomber sur le sol, provoquant la chute d’objets métalliques qui résonnent incongrûment dans le silence de la nuit. Fabrice aboie en sourdine :
– Planquez-vous, bande de nazes, et mettez la cagoule. Elle va rappliquer. Faut pas qu’elle gueule.
Quand Josiane entre, elle est attrapée, frappée et poussée vers le fond de la roulotte. Inerte, les yeux exorbités, ne cherchant même pas à se protéger des coups, elle trébuche et tombe assise en équilibre sur une fesse, à l’extrême bord de son lit. De grosses mèches grisâtres lui cachent en partie le visage. Son menton, soudé à sa poitrine, trahit une tension extrême. Sa jupe s’est relevée dans la bagarre, on aperçoit ses genoux sales.
– Si tu bouges, couic, dit Fabrice qui fait un geste tranchant du pouce sur sa gorge. T’as pigé salope ?
Pas un souffle ne sort de ce corps pétrifié. Décontenancé, Fabrice enlève sa cagoule. C’est trop facile. C’est décevant même. Un silence bizarre a fait tomber l’excitation des jeunes gens. Fabrice attrape une bouteille machinalement et boit au goulot. Les deux autres l’imitent. Peu à peu le ton monte. Les garçons comparent les différentes marques, guettant du coin de l’oeil une réaction de la vieille. Elle ne bouge toujours pas. Les alcools leur donnent soif, ils décapsulent alors des canettes de bière.
Benoît s’approche de Josiane et par jeu, il la pousse pour la faire tomber. Elle résiste tout d’un bloc.
– Hé, regardez-la ! On dirait une statue. Tu vas bouger, salope !
Il la pousse de plus en plus fort jusqu’à ce qu’elle cède enfin, et tombe à la renverse sur le lit en lâchant un cri aigu.
– Paraît qu’t’aime les militaires, grognasse.
Avec le goulot de sa canette, il relève la jupe bariolée, pleine de trous, et découvre des cuisses crémeuses, douces, propres et bien formées. Benoît en laisse tomber sa mâchoire d’étonnement.
– Hé, les gars ! Articule-t-il en pointant sa canette vers les jambes de la vieille.
Josiane se crispe davantage. Elle a déjà vécu ça, elle s’attend au pire… Et le pire arrive.
Par paresse ou par indifférence, ce soir-là Stéphane ne participe pas au viol. Il se pinte consciencieusement, un Johny Walker trois étoiles qui vaut le déplacement. Il a ramassé un jeu de cartes crasseux et s’exerce à faire des réussites. Mais bientôt ivre mort, il laisse tomber sa tête sur la table. Il perçoit des bribes de conversation, des bruits de claques : Benoît et Fabrice délirent sur la suite du traitement à infliger à la folle.
– Stéph, réveille-toi, on va pisser. Stéph !
Fabrice le bourre de coups de poing. Stéphane ouvre péniblement les yeux.
– On va arroser ces merdes de saloperies de tableaux. Surveille-la. T’entends ? Allez, lève-toi.
Stéphane se redresse lentement, vacillant sur ses pieds. Il n’a pas lâché sa bouteille de Wisky. Il a le vague sentiment d’avoir dépassé sa dose habituelle. Il titube jusqu’au lit et se laisse tomber assis à côté de la folle. La porte claque, les rires étouffés de ses copains s’éloignent.
Le chemisier déchiré de Josy révèle un sein gonflé, neigeux, sur lequel son regard s’obnubile. Il ne prend pas conscience que sa bouteille glisse sans bruit sur le tapis crasseux. Josy la ramasse délicatement, sans presque bouger le corps.
Et elle la fracasse d’un geste fulgurant sur la tempe du garçon.
Il s’écroule sur le lit. Josy tend l’oreille. Elle perçoit un remue-ménage, des rires d’ivrognes en provenance de son atelier. Son regard glisse, inexpressif, sur le corps étendu à côté d’elle, sur le bras droit qui pend dans le vide, elle en devine les grosses veines saillantes. Elle pose une main légère sur le poignet du garçon et commence à le caresser. Sans cesser sa caresse, elle ramasse un tesson de bouteille de l’autre main et fait jouer la lumière de la bougie à travers le morceau de verre. Brusquement elle entaille la peau. Elle sent le liquide tiède lui inonder la main.
Stéphane geint. Elle lui lâche le poignet pour s’essuyer les doigts sur sa jupe déjà poisseuse de son propre sang, puis elle masse les cicatrices de ses poignets d’un air absent. Elle se relève enfin et se tient immobile au centre de la pièce. Elle entend les beuglements des deux autres qui scandent « Stéphane, Stéphane » pour le faire participer à la fête.
Josy frissonne. Elle décolle la bougie de la table et, la protégeant de sa main repliée, elle sort se terrer derrière une carcasse de voiture. À peine est-elle accroupie que Fabrice pousse la porte de l’atelier. Il appelle encore Stéphane mais d’une voix plus étouffée, craignant de se faire repérer des voisins. Il entre dans la baraque sombre, pestant contre ce con qui a éteint la bougie.
Dès qu’il a disparu à l’intérieur, Josy attrape un bidon rouillé posé sur la banquette de l’épave. Ses mains, ses jambes, son menton tremblent mais néanmoins elle avance à croupetons avec détermination vers son atelier. Elle hausse la tête et jette un coup d’oeil par la fenêtre. Le troisième garçon barbouille une de ses toiles. Il semble y prendre du plaisir, déposant ça et là des petites touches de couleur avec des gestes maniérés. Elle l’entend débiter des obscénités. Elle ne s’attarde pas à contempler les ravages qu’ils ont fait dans les tubes de couleurs, les bidons de produits, les dessins, les toiles. Elle vide rapidement l’essence au pied des murs. Un tour de clé à la serrure. Elle récupère la bougie. Le feu s’étend à une vitesse effrayante. Elle n’a que le temps de se projeter en arrière. Elle trottine une trentaine de mètres sur le chemin, puis elle se fige.
D’un seul coup le peintre amateur beugle son angoisse. Fabrice jaillit au dehors. Il veut se jeter contre la porte en flamme, mais il ne peut s’en approcher. Il lance alors à grands gestes maladroits tout ce qui lui tombe sous la main pour tenter de défoncer la porte ou la fenêtre. Il perd l’équilibre plusieurs fois. Une fumée épaisse le fait tousser. Les vitres explosent. Les cris se sont tus à l’intérieur.
Quand Fabrice distingue la silhouette de Josy, immobile, éclairée par le feu, il se fonce vers elle avec des cris de rage. Il trébuche plusieurs fois. Il ne la rattrape qu’à l’enclos des deux pittbulls de pépé Georges où elle l’attend, plaquée contre la palissade. Quand il n’est plus qu’à quelques pas, elle fait glisser le gros loquet de bois et tire violemment la porte vers elle. Les chiens, qu’elle a souvent nourris, l’ignorent et sautent à la gorge de l’inconnu. Des militaires envahissent déjà le terrain, le planton effaré en tête. Elle n’assiste pas à la curée.
Sans un regard vers les deux baraquements en flamme, elle se met en route pour aller retrouver monsieur Ben Amin, à l’hôpital.
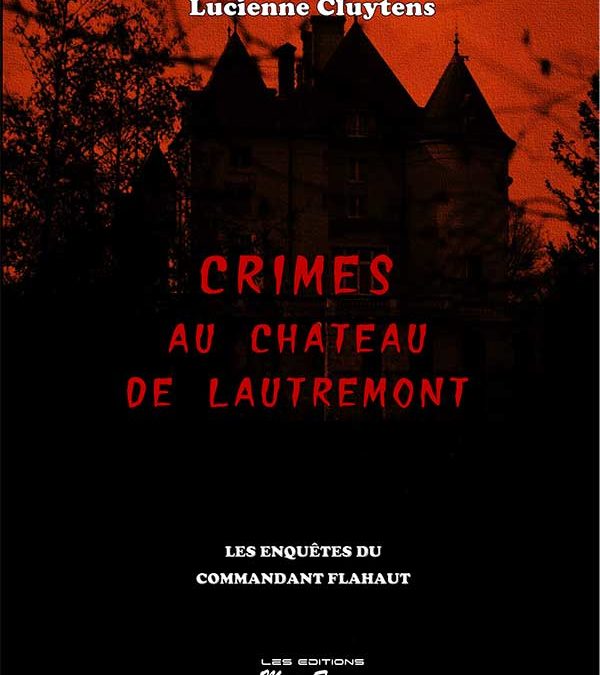

Ben dis donc, tu n’y allais pas avec le dos de la cuillère!